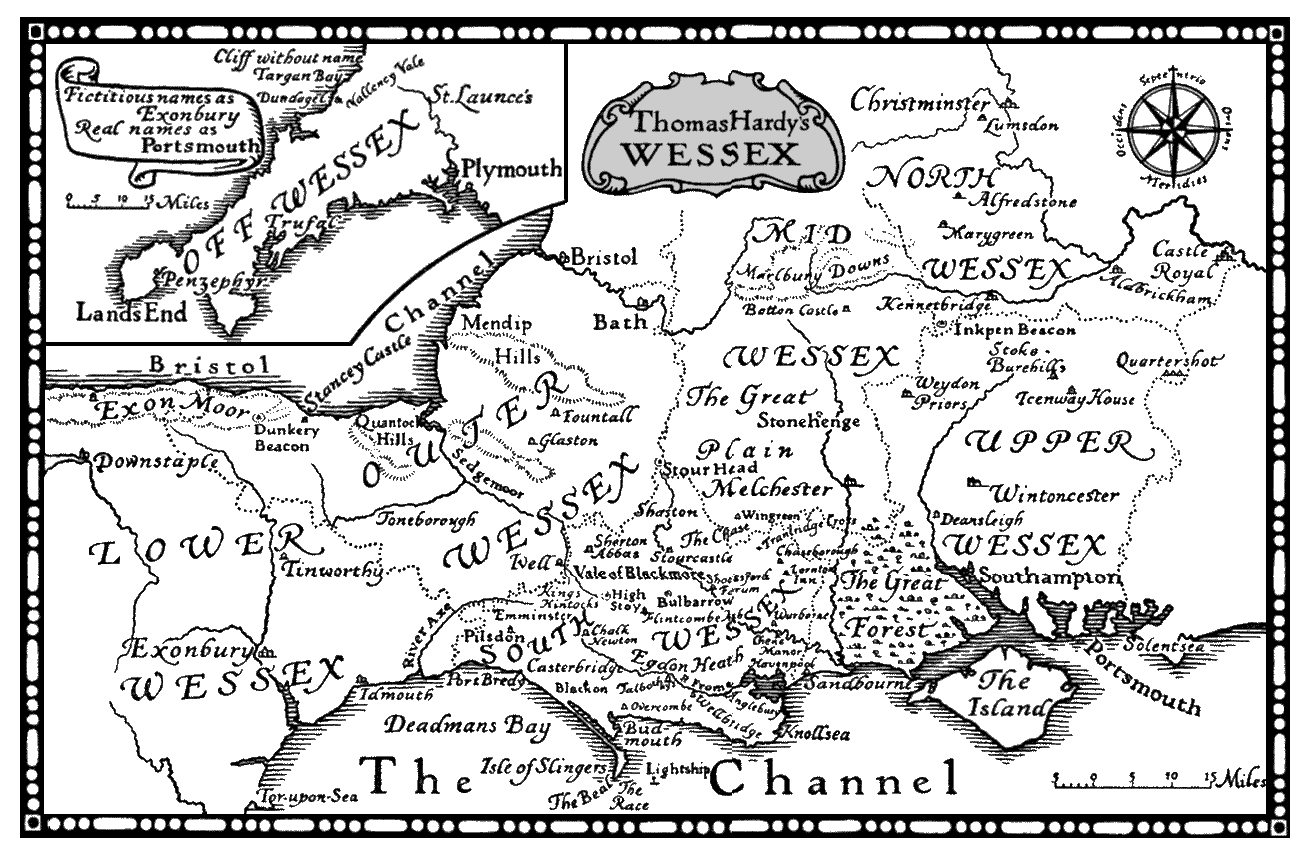Le site du parti de l'In-nocence
Charte d'utilisation des forums publics du parti de l'In-nocence
Bienvenue - Identification - Créer un nouveau profil
Bienvenue - Identification - Créer un nouveau profil
Thomas Hardy et le clinamen
Envoyé par Francis Marche
| 23 mai 2017, 01:04 Thomas Hardy et le clinamen |
Les siècles se suivent et, face au destin, au fatum, ne se ressemblent pas, du moins en littérature. Longtemps, et encore, semble-t-il, aujourd’hui, le destin, en Occident, n’a pas été donné à n’importe qui. Ce furent d’abord rois et princes, et princesses et filles de tyran, qui en connurent le privilège, les grands hommes et leurs filles et femmes, puis, à l’époque médiévale, les preux chevaliers, plus tard, à l’âge classique, la noblesse et bientôt, dans le XIXe siècle, la bourgeoisie. Mais le XIXe siècle fut double à l’égard du destin : la facette individuelle du destin fut l’apanage du bourgeois, cependant que l’homme du commun ne connut de destin pensable qu’au collectif. L’homme du commun, duquel le dandy baudelairien se distingue, se démarque du bourgeois par le caractère « en commun », comme on le dit des transports, du destin qui le touche ou l’accable, ou le porte vers la puissance. Point de destin individuel hors la bourgeoisie au XIXe siècle. Le plébéien, ou le prolétaire, promis à émettre comme un soleil la lumière de l’aube d’un âge nouveau par les destinées collectives que lui assignait le marxisme, restait exclu de toute destinée singulière ou seulement solitaire.
Le héros stendhalien est destinal, qui le contesterait, mais sa figure est hors du commun, par la naissance, voire par l’éducation, ou par les fées discriminantes penchées sur son berceau, comme le sont le héros ou l’héroïne rousseauistes, et il n’est guère, marginalement, que chez Balzac, avec le Colonel Chabert, que le fait destinal vient frapper d’ironie apollinienne l’homme d’extraction obscure.
L’œuvre du destin est non-édifiante et ouvre la porte au nihilisme, gouffre répugnant à Hugo. Face à cette œuvre rectiligne comme un i, à l’action destinale crue et débridée, toute résistance est exclue, et chez Hugo le destin en est statique, incontesté, seul à agir, souverain sans contestation ni collaboration de ses sujets et victimes.
Et ce n’est finalement qu’à la charnière du XXe siècle que la mécanique destinale commence à effleurer la femme du commun, l’homme de rien. Je dis effleurer car il est remarquable que le destin, touchant enfin ces couches inférieures de la société, ne change rien à la condition de l’élu qu’il désigne. Le destin frappe à la porte de son choix pour se faire connaître des sujets qui l’accueillent comme porteur d’annonce, mais l’annonce ainsi faite aux humbles n'assigne aucun bouleversement au logis, n'instruit d'aucun renversement de l’ordre social ou du monde comme cela avait pu être le cas dans les siècles passées quand il frappait à l’huis des palais. L’individu ainsi touché n’est invité par le destin qu’à tenir le rôle de témoin de l’action destinale, témoin privilégié, irremplaçable, témoin du message de grande pureté qui énonce ce trait : il y a destin, sans plus d’invite à être emporté par lui, ni à en bouleverser l’ordre mondain. Le destin individuel se manifeste à lui bien absurdement, autrement qu’à Hélène ou Antigone : comme porteur d’un message qui témoigne qu’il y a seulement destin et qui vaut ainsi invite à son destinataire de témoigner à son tour, par répercussion, qu’il y a bien insaisissable destin. Cette formule de transmission ou répercussion est celle du souvenir rapporté de l’homme qui se souvient que nous avons vu opérer dans l’histoire conradienne de Karain. Le message dit « il y a message », et c’est tout. Mais cette position de « témoin assisté » qui est celle du personnage foudroyé par le destin dans le siècle neuf n’est pas de tout repos – elle suppose une lutte âpre et consciente avec la machine destinale : l’humble choix de l’homme du commun, en lequel sa pauvre vie est engagée, le destin l’exige comme il exigeait des rois de trancher le cours du monde, mais sans jamais la tragique contrepartie que le monde dans sa grandeur pourrait s’en ressentir. Il exige la collaboration du sujet pour l’établissement de sa seule preuve ontologique : le destin est là, il ne s’éclipse jamais, son jeu est constant, son exigence absolue mais pour rien, sinon pour le seul dit du destin, le rappel salubre, obsédant et désespérant que rien, jamais, ne se fera sans lui.
La question du clinamen, qui fit tant couler d’encre depuis Lucrèce, resurgit à la fin du XIXe siècle avec les fictions témoignages de Conrad et de Thomas Hardy dans le domaine anglais. Le clinamen, « concept difficile » selon Comte-Sponville, c’est l’accident destinal. Le penchant qui ne se manifestera jamais sans l’action du sujet qui en est marqué, lors même que cette action se veut agonistique à ce penchant. Lutter contre l’accident, c’est l’exalter en un cours destinal et la lutte en devient collaboration active à l’œuvre destinale qui ne pouvait se passer de soi et de son prétendu libre-arbitre. Toute hésitation, toute absence de choix, dans ce corps à corps, cette lutte de Jacob avec l’Ange qui est une danse travestie en combat, accompagne et accomplit les volontés du destin. L’obstacle, la mise en travers du cours annoncé des choses, est tout ce que le destin attendait pour agir. Le clinamen, c’est l’accident indispensable, le vent de biais qui fait la pluie aux traits parallèles dérangés inonder la terre là où il le fallait pour l’éclosion et le destin de la plante. La plante ainsi, avant que d’être, aura appelé non point la pluie mais l’accident du clinamen. La rectitude de chute des gouttes de pluie, celle que gouverne l'infaillible loi de gravitation qui en dirige le cours, aura été perturbée par le vent, ou par l’homme, aveugle traversier des orages, pour féconder l’inertie des choses et amener l’inconnu à être ou à se manifester.
Je vous propose de lire ensemble une nouvelle de Thomas Hardy, The Melancholy Hussard of the German Legion, parue en octobre 1888, que je traduirai comme d’habitude ici, sur site, au fil de la plume et sans me soucier des éventuelles versions françaises existantes. Comme pour le Karain de Conrad qui mettait des souvenirs en abymes, cette nouvelle nous met en présence du récit fait par un homme qui se souvient d’une vieille femme qui se souvenait. Cette femme s’était souvenue d’un épisode tragique de sa jeunesse dans une ferme du sud de l’Angleterre (le fameux Wessex de Hardy, pays imaginaire ou semi-imaginaire, comme pouvait l’être la Provence de Giono ou le comté de Yoknapatawpha chez William Faulkner). C’était en 1806 et le roi George, face à Napoléon, et habité de velléités de s’en inspirer en l’affrontant, a recruté une légion allemande, dans le Hanovre et la Saxe, mais aussi en Alsace. Cette unité de soldats germaniques se trouve accompagner le souverain dans le Wessex où sa majesté « va aux eaux ». Une jeune fille, sur un mur, celui de la propriété de son père, médecin veuf et solitaire, assez ours, observe de loin le manège de la garnison. Elle a été récemment fiancée à un jeune homme de bonne famille de sa région, qui s’en est allé aussitôt en lui laissant une vague promesse de retour. La jeune fille est intriguée et éprouve une attirance pour « les beaux étrangers », les militaires à brandebourgs qui sont là. Le destin alors, s’en mêle ; il se mêle aux hommes comme un ange annonciateur ou comme un homme, comme le fait anonymement l’homme des foules de E.A. Poe. Point de social ici, pas plus que dans Conrad, mais la seule dure et essentielle loi des choses mal voulues et qui écrasent le monde de leur fait et qui choisissent leur homme ou leur femme dans une volonté obsédée, âpre et têtue de découdre tout l’existant qui tombe sous sa foudre. Le temps n’est qu’un accident d’un accident, écrit Comte-Sponville dans son livre sur Lucrèce (Le Miel et l’Absinthe): donc ce qui advient n’est qu’accidentellement fatal, mais ce mode de l’accident, partenaire des désirs et assassin des volontés, refonde l’absolu. L’historien retiendra qu’il le refonda pour la première fois dans ce moment épokhéal de l’histoire de l’Occident – les trois décennies qui précédèrent la première guerre mondiale – et probablement aussi pour la dernière fois, le destin massique reprenant le dessus sur les hommes et les femmes du commun au XXe siècle, ceux qui ne sont pas « les people », et qui n’eurent pas l’heur d’évoluer dans la Provence de Giono ni le comté Yoknapatawha de Faulkner.
(à suivre)
Le héros stendhalien est destinal, qui le contesterait, mais sa figure est hors du commun, par la naissance, voire par l’éducation, ou par les fées discriminantes penchées sur son berceau, comme le sont le héros ou l’héroïne rousseauistes, et il n’est guère, marginalement, que chez Balzac, avec le Colonel Chabert, que le fait destinal vient frapper d’ironie apollinienne l’homme d’extraction obscure.
L’œuvre du destin est non-édifiante et ouvre la porte au nihilisme, gouffre répugnant à Hugo. Face à cette œuvre rectiligne comme un i, à l’action destinale crue et débridée, toute résistance est exclue, et chez Hugo le destin en est statique, incontesté, seul à agir, souverain sans contestation ni collaboration de ses sujets et victimes.
Et ce n’est finalement qu’à la charnière du XXe siècle que la mécanique destinale commence à effleurer la femme du commun, l’homme de rien. Je dis effleurer car il est remarquable que le destin, touchant enfin ces couches inférieures de la société, ne change rien à la condition de l’élu qu’il désigne. Le destin frappe à la porte de son choix pour se faire connaître des sujets qui l’accueillent comme porteur d’annonce, mais l’annonce ainsi faite aux humbles n'assigne aucun bouleversement au logis, n'instruit d'aucun renversement de l’ordre social ou du monde comme cela avait pu être le cas dans les siècles passées quand il frappait à l’huis des palais. L’individu ainsi touché n’est invité par le destin qu’à tenir le rôle de témoin de l’action destinale, témoin privilégié, irremplaçable, témoin du message de grande pureté qui énonce ce trait : il y a destin, sans plus d’invite à être emporté par lui, ni à en bouleverser l’ordre mondain. Le destin individuel se manifeste à lui bien absurdement, autrement qu’à Hélène ou Antigone : comme porteur d’un message qui témoigne qu’il y a seulement destin et qui vaut ainsi invite à son destinataire de témoigner à son tour, par répercussion, qu’il y a bien insaisissable destin. Cette formule de transmission ou répercussion est celle du souvenir rapporté de l’homme qui se souvient que nous avons vu opérer dans l’histoire conradienne de Karain. Le message dit « il y a message », et c’est tout. Mais cette position de « témoin assisté » qui est celle du personnage foudroyé par le destin dans le siècle neuf n’est pas de tout repos – elle suppose une lutte âpre et consciente avec la machine destinale : l’humble choix de l’homme du commun, en lequel sa pauvre vie est engagée, le destin l’exige comme il exigeait des rois de trancher le cours du monde, mais sans jamais la tragique contrepartie que le monde dans sa grandeur pourrait s’en ressentir. Il exige la collaboration du sujet pour l’établissement de sa seule preuve ontologique : le destin est là, il ne s’éclipse jamais, son jeu est constant, son exigence absolue mais pour rien, sinon pour le seul dit du destin, le rappel salubre, obsédant et désespérant que rien, jamais, ne se fera sans lui.
La question du clinamen, qui fit tant couler d’encre depuis Lucrèce, resurgit à la fin du XIXe siècle avec les fictions témoignages de Conrad et de Thomas Hardy dans le domaine anglais. Le clinamen, « concept difficile » selon Comte-Sponville, c’est l’accident destinal. Le penchant qui ne se manifestera jamais sans l’action du sujet qui en est marqué, lors même que cette action se veut agonistique à ce penchant. Lutter contre l’accident, c’est l’exalter en un cours destinal et la lutte en devient collaboration active à l’œuvre destinale qui ne pouvait se passer de soi et de son prétendu libre-arbitre. Toute hésitation, toute absence de choix, dans ce corps à corps, cette lutte de Jacob avec l’Ange qui est une danse travestie en combat, accompagne et accomplit les volontés du destin. L’obstacle, la mise en travers du cours annoncé des choses, est tout ce que le destin attendait pour agir. Le clinamen, c’est l’accident indispensable, le vent de biais qui fait la pluie aux traits parallèles dérangés inonder la terre là où il le fallait pour l’éclosion et le destin de la plante. La plante ainsi, avant que d’être, aura appelé non point la pluie mais l’accident du clinamen. La rectitude de chute des gouttes de pluie, celle que gouverne l'infaillible loi de gravitation qui en dirige le cours, aura été perturbée par le vent, ou par l’homme, aveugle traversier des orages, pour féconder l’inertie des choses et amener l’inconnu à être ou à se manifester.
Je vous propose de lire ensemble une nouvelle de Thomas Hardy, The Melancholy Hussard of the German Legion, parue en octobre 1888, que je traduirai comme d’habitude ici, sur site, au fil de la plume et sans me soucier des éventuelles versions françaises existantes. Comme pour le Karain de Conrad qui mettait des souvenirs en abymes, cette nouvelle nous met en présence du récit fait par un homme qui se souvient d’une vieille femme qui se souvenait. Cette femme s’était souvenue d’un épisode tragique de sa jeunesse dans une ferme du sud de l’Angleterre (le fameux Wessex de Hardy, pays imaginaire ou semi-imaginaire, comme pouvait l’être la Provence de Giono ou le comté de Yoknapatawpha chez William Faulkner). C’était en 1806 et le roi George, face à Napoléon, et habité de velléités de s’en inspirer en l’affrontant, a recruté une légion allemande, dans le Hanovre et la Saxe, mais aussi en Alsace. Cette unité de soldats germaniques se trouve accompagner le souverain dans le Wessex où sa majesté « va aux eaux ». Une jeune fille, sur un mur, celui de la propriété de son père, médecin veuf et solitaire, assez ours, observe de loin le manège de la garnison. Elle a été récemment fiancée à un jeune homme de bonne famille de sa région, qui s’en est allé aussitôt en lui laissant une vague promesse de retour. La jeune fille est intriguée et éprouve une attirance pour « les beaux étrangers », les militaires à brandebourgs qui sont là. Le destin alors, s’en mêle ; il se mêle aux hommes comme un ange annonciateur ou comme un homme, comme le fait anonymement l’homme des foules de E.A. Poe. Point de social ici, pas plus que dans Conrad, mais la seule dure et essentielle loi des choses mal voulues et qui écrasent le monde de leur fait et qui choisissent leur homme ou leur femme dans une volonté obsédée, âpre et têtue de découdre tout l’existant qui tombe sous sa foudre. Le temps n’est qu’un accident d’un accident, écrit Comte-Sponville dans son livre sur Lucrèce (Le Miel et l’Absinthe): donc ce qui advient n’est qu’accidentellement fatal, mais ce mode de l’accident, partenaire des désirs et assassin des volontés, refonde l’absolu. L’historien retiendra qu’il le refonda pour la première fois dans ce moment épokhéal de l’histoire de l’Occident – les trois décennies qui précédèrent la première guerre mondiale – et probablement aussi pour la dernière fois, le destin massique reprenant le dessus sur les hommes et les femmes du commun au XXe siècle, ceux qui ne sont pas « les people », et qui n’eurent pas l’heur d’évoluer dans la Provence de Giono ni le comté Yoknapatawha de Faulkner.
(à suivre)
| 23 mai 2017, 09:44 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
Un point d'histoire avant d'entreprendre cette traduction : l'origine de la King's German Legion du roi George, en 1806, est celle d'une désertion de masse de la légion hanovrienne de Napoléon. Wikipédia :
En 1803, les troupes françaises du général Mortier occupent l'électorat du Hanovre, possession de la famille royale britannique. Le Premier consul Napoléon Bonaparte en profite pour ordonner l'organisation d'une légion hanovrienne combinant une unité de cavalerie et un régiment d'infanterie légère. Un dépôt est installé à Celle pour y recevoir les recrues, mais les prescriptions de Napoléon doivent être revues à la baisse : en effet, la plupart des soldats de l'ex-armée hanovrienne se sont réfugiés en Angleterre et se sont enrôlés dans la King's German Legion.
Nous verrons comment cette trahison originelle, ce balancement entre les deux camps de la belligérance, est vécu destinalement par un balancement miroir dans le coeur de l'héroïne du récit, la jeune Phyllis. Et comment le retour du balancier, celui des traitres à la France retournant vers la France imité par celui du coeur de Phyllis vers le fiancé dont elle s'était détournée, arme le destin comme le remontoir d'une horloge reliée à un détonateur. Ne pas savoir choisir entre deux maîtres, laisser choisir le destin pour soi, et lutter à toute force dans l'espoir vain d'en empêcher son foudroiement, revient à fourbir docilement, avec un art supérieur car sans maîtrise autre que l'instinct qui en guide les gestes, les armes du fatum tragique.
En 1803, les troupes françaises du général Mortier occupent l'électorat du Hanovre, possession de la famille royale britannique. Le Premier consul Napoléon Bonaparte en profite pour ordonner l'organisation d'une légion hanovrienne combinant une unité de cavalerie et un régiment d'infanterie légère. Un dépôt est installé à Celle pour y recevoir les recrues, mais les prescriptions de Napoléon doivent être revues à la baisse : en effet, la plupart des soldats de l'ex-armée hanovrienne se sont réfugiés en Angleterre et se sont enrôlés dans la King's German Legion.
Nous verrons comment cette trahison originelle, ce balancement entre les deux camps de la belligérance, est vécu destinalement par un balancement miroir dans le coeur de l'héroïne du récit, la jeune Phyllis. Et comment le retour du balancier, celui des traitres à la France retournant vers la France imité par celui du coeur de Phyllis vers le fiancé dont elle s'était détournée, arme le destin comme le remontoir d'une horloge reliée à un détonateur. Ne pas savoir choisir entre deux maîtres, laisser choisir le destin pour soi, et lutter à toute force dans l'espoir vain d'en empêcher son foudroiement, revient à fourbir docilement, avec un art supérieur car sans maîtrise autre que l'instinct qui en guide les gestes, les armes du fatum tragique.
| 23 mai 2017, 16:17 Les deux Georges |
Le caractère "destinal" de l'accident clinaménique me gêne un peu : d'abord il me fait penser, pour une raison inconnue, à l'élocution particulière de feu Georges Marchais ; ensuite, comme l'écrivait Georges Perros : « Avoir un destin, quelle ânerie ! C'est se délivrer de tout destin qui compte un peu. » (Papiers collés 2)
À prendre ou à laisser.
À prendre ou à laisser.
| 23 mai 2017, 17:13 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
| 23 mai 2017, 20:14 Petite discut' philo sympa ou la vérité-correspondance |
Alors là Francis, cela pourrait être tout le contraire : si l'on pose que la vie en soi n'a aucun sens (ce qui se pourrait fort bien au demeurant), la vivre à l'encontre de tout destin entendu comme détermination préconçue et imposée, en toute consciente indétermination choisie, est alors la chose la plus signifiante qui soit, puisque c'est être dans le vrai, qui consiste dans l'adéquation au réel.
| 23 mai 2017, 21:57 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
Le destin n'est évidemment pas entendu ici comme une "détermination préconçue et imposée", la foudre qui s'abat est-elle une "détermination préconçue et imposée" ? Je me tue à écrire en long en large et en travers et encore en pédagogisant comme je ne le devrais pas que c'est justement quand est choisie la consciente indétermination que le fatum prend le pouvoir. Celui qui ne choisit pas est choisi. C'est si difficile à comprendre ? Bref, on est fondé de s'ériger contre cette idée, de mille manières et avec mille bonnes raisons que je ne discuterai pas, mais la vouloir insignifiante n'a aucune espèce de sens à moins de juger insignifiante toute vision ou interprétation du réel qui n'est pas la sienne.
Au fait, je ne vois pas ce que "le vrai" ou "l'adéquation au réel" peut avoir à faire dans l'étude ou la méditation ou la description d'un phénomène qui est celui d'un ordre donné qui s'impose à nos vies et nous prend dans ses rets.
L'événement ou la configuration mortelle (fatale) qui nous saisit, se crée, se saisit comme une sauce, se fige ou "se cristallise" comme on dit partout en cette saison, a le corps défendant pour auxiliaire de ses oeuvres quand la défense est faible. Et elle l'est d'autant plus que le sujet à fait le choix de l'indétermination. Qui plus est, pareil choix reste tout théorique : dans l'écrasante majorité des cas, le fatum mord sur une vie parce que le choix d'indétermination, ou au contraire le choix du choix, ont été l'un ou l'autre imparfait. Le vacillant est une proie de choix, justement, pour le fatum, qui l'épie comme l'aigle le lapereau frémissant. Le fatum sanctionne et châtie l'imperfection du choix, et à fortiori le choix de ne pas choisir.
Au fait, je ne vois pas ce que "le vrai" ou "l'adéquation au réel" peut avoir à faire dans l'étude ou la méditation ou la description d'un phénomène qui est celui d'un ordre donné qui s'impose à nos vies et nous prend dans ses rets.
L'événement ou la configuration mortelle (fatale) qui nous saisit, se crée, se saisit comme une sauce, se fige ou "se cristallise" comme on dit partout en cette saison, a le corps défendant pour auxiliaire de ses oeuvres quand la défense est faible. Et elle l'est d'autant plus que le sujet à fait le choix de l'indétermination. Qui plus est, pareil choix reste tout théorique : dans l'écrasante majorité des cas, le fatum mord sur une vie parce que le choix d'indétermination, ou au contraire le choix du choix, ont été l'un ou l'autre imparfait. Le vacillant est une proie de choix, justement, pour le fatum, qui l'épie comme l'aigle le lapereau frémissant. Le fatum sanctionne et châtie l'imperfection du choix, et à fortiori le choix de ne pas choisir.
| 24 mai 2017, 11:35 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
Comte-Sponville traitant du clinamen au chapitre VIII (intitulé Le hasard et la liberté) de son livre sur le De Rerum Natura en explore les traits, en cerne la définition. Le clinamen est l'accident destinal créatif qui rompt la chaîne des causes (l'enfer de l'enchaînement mécanique des causes cher aux physiciens) et se trouve être lui-même un sans cause, comme le serait l'atome. Il serait hors les causes et pourtant adjuvant causal traversier à la chaîne physique des causes verticales (Comte-Sponville rappelle que "le poids des choses verticalise l'espace") : interrupteur, ou rupteur, des séquences causales, il en crée de nouvelles, implacables et précipitées plus encore que ne le sont celles qui sont propres au rerum natura.
Dès lors une conjecture se présente : si, dans les lois de la nature, l'indispensable clinamen fait incliner l'ordre naturel vers un mouvement créateur, s'il est phénomène et agent perturbateur transversal (ou "traversier") et trace le destin, s'il guide, par accident (mais il est lui-même accident) la frappe du fatum, alors dans l'ordre de la nature, il est la figure de l'homme. Il figure, au sens philosophique, l'homme idéal. Si nous pouvons poser que le locus anthropologique dans le rerum natura est celui-là même du clinamen, que cette place est figurée par le concept de clinamen, si, en un mot la figure de l'homme dans le tissus historique nous est donnée comme entièrement assimilable à ce dernier dans l'ordre naturel, c'est sur la foi des effets constatables que l'apparition de l'homme produit dans le concert des choses. Et le concept de clinamen chez Lucrèce en serait une guise archi-précoce de la figure de l'homme qui devait se former en Occident dans le second millénaire de son histoire.
Le clinamen tiendrait dans la nature le rôle de Matthaus Tina face à Phyllis dans cette nouvelle de Thomas Hardy : l'homme pur et idéal, venu d'on ne sait où, allant on ne sait où, l'élément acausal qui n'appartient pas aux coordonnées de l'espace temps local, -- le narrateur souligne que Matthaus paraît à Phyllis comme hors du temps parce que sans maison ni lignée, (he was not a house-dweller) --, et précipitant par sa seule apparition la création destinale. Ne nous y trompons pas : si, aux yeux de Phyllis, Matthaus est perçu comme "homme idéal", s'il se fait connaître dans l'ordre local comme tel, ce n'est pas parce que l'histoire nous conte une bluette dans laquelle ce personnage masculin serait celui du prince charmant dont rêvent les jeunes filles nubiles. Matthaus et Phyllis oscillent, balancent mêmement : lui entre deux nations, deux bords militaires, une puissance insulaire et un continent ; elle entre une promesse d'épousailles dont la substance paraît s'évanouir et une passion dangereuse qui veut l'aspirer vers l'inconnu, vers la désertion du monde connu (son coin d'Angleterre, et tout le monde insulaire qui fait ce pays). Et c'est ce ballet d'oscillations, ce pas de deux fait de vacillements entre cette femme et cet homme, qui invitent et provoquent la frappe du destin, qui confient à l'accident destinal le pouvoir de vie et de mort sur leur existence. L'imperfection du choix, le trouble, la perclusion des sujets tentent la frappe du tragique spectaculaire. Etre ou ne pas être ? La belle affaire ! que le fatum va s'employer à trancher avec l'éloquence qu'on lui connaît ! Si Matthaus s'impose à Phyllis comme homme idéal, c'est parce qu'il est essentiellement homme-accident, inclination et bascule créatrices, et par conséquent pure figure destinale, pur prétexte au déchaînement destinal, déclencheur de l'orage des choses dérangées.
Portrait de Matthaus Tina sur le site logarritmo.deviantart :

J'entame la traduction à l'écran suivant, promis.
Dès lors une conjecture se présente : si, dans les lois de la nature, l'indispensable clinamen fait incliner l'ordre naturel vers un mouvement créateur, s'il est phénomène et agent perturbateur transversal (ou "traversier") et trace le destin, s'il guide, par accident (mais il est lui-même accident) la frappe du fatum, alors dans l'ordre de la nature, il est la figure de l'homme. Il figure, au sens philosophique, l'homme idéal. Si nous pouvons poser que le locus anthropologique dans le rerum natura est celui-là même du clinamen, que cette place est figurée par le concept de clinamen, si, en un mot la figure de l'homme dans le tissus historique nous est donnée comme entièrement assimilable à ce dernier dans l'ordre naturel, c'est sur la foi des effets constatables que l'apparition de l'homme produit dans le concert des choses. Et le concept de clinamen chez Lucrèce en serait une guise archi-précoce de la figure de l'homme qui devait se former en Occident dans le second millénaire de son histoire.
Le clinamen tiendrait dans la nature le rôle de Matthaus Tina face à Phyllis dans cette nouvelle de Thomas Hardy : l'homme pur et idéal, venu d'on ne sait où, allant on ne sait où, l'élément acausal qui n'appartient pas aux coordonnées de l'espace temps local, -- le narrateur souligne que Matthaus paraît à Phyllis comme hors du temps parce que sans maison ni lignée, (he was not a house-dweller) --, et précipitant par sa seule apparition la création destinale. Ne nous y trompons pas : si, aux yeux de Phyllis, Matthaus est perçu comme "homme idéal", s'il se fait connaître dans l'ordre local comme tel, ce n'est pas parce que l'histoire nous conte une bluette dans laquelle ce personnage masculin serait celui du prince charmant dont rêvent les jeunes filles nubiles. Matthaus et Phyllis oscillent, balancent mêmement : lui entre deux nations, deux bords militaires, une puissance insulaire et un continent ; elle entre une promesse d'épousailles dont la substance paraît s'évanouir et une passion dangereuse qui veut l'aspirer vers l'inconnu, vers la désertion du monde connu (son coin d'Angleterre, et tout le monde insulaire qui fait ce pays). Et c'est ce ballet d'oscillations, ce pas de deux fait de vacillements entre cette femme et cet homme, qui invitent et provoquent la frappe du destin, qui confient à l'accident destinal le pouvoir de vie et de mort sur leur existence. L'imperfection du choix, le trouble, la perclusion des sujets tentent la frappe du tragique spectaculaire. Etre ou ne pas être ? La belle affaire ! que le fatum va s'employer à trancher avec l'éloquence qu'on lui connaît ! Si Matthaus s'impose à Phyllis comme homme idéal, c'est parce qu'il est essentiellement homme-accident, inclination et bascule créatrices, et par conséquent pure figure destinale, pur prétexte au déchaînement destinal, déclencheur de l'orage des choses dérangées.
Portrait de Matthaus Tina sur le site logarritmo.deviantart :

J'entame la traduction à l'écran suivant, promis.
| 24 mai 2017, 15:29 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
La foudre qui s'abat n'est en rien "accidentelle" mais est parfaitement déterminée dans un strict enchaînement causal produit par un ordre naturel : en cela elle est une détermination préformée dans une suite prévisible, pour autant qu'on dispose de tous les paramètres, de causes et d'effets et qui, si elle s’abat punkt à l'endroit où vous vous trouvez, s'impose à vous quoi que vous en ayez.
Le caractère accidentel ou hasardeux de la chose n'est dû qu'au fait qu'il échappe en principe à votre (pre)science, votre contrôle, et donc à votre volonté : c'est donc une force au déroulement parfaitement réglé — qu'elle soit "aveugle" ou de quelque façon planifiée ne change rien en l'occurrence — qui vous plie à son caprice à votre corps défendant : ce que l'on peut parfaitement appeler "destin" dans le sens que j’ai dit, je crois.
Cela me rappelle une discussion que nous eûmes à propos du hasard, et dans le fond je ne changerais rien à ce que je vous écrivis alors : "jusqu'à plus ample informé, le hasard n'est que le résultat de l'impossibilité de rattacher un événement comme effet à une cause déterminante. À la survenue d'un tel événement on dit alors, façon de parler, qu'il est "dû" au hasard, mais ce n'est à mon avis que fallacieuse positivation d'un manque, d'une absence d'information."
Dans ce cas, vous en conviendrez, le clinamen ne peut être un "sans cause" en soi, seulement un "sans cause connue" par manque de faculté de résolution exhaustive du réel.
Mais je voudrais si vous permettez revenir à la question de la "signifiance" qu'il y aurait à se délivrer de tout destin, en prenant l'exact contre-pied de votre formule : Celui qui ne choisit pas est choisi, en faisant valoir que celui qui choisit de refuser d'être choisi atteint au plus haut degré de signifiance, précisément, dont il soit capable, puisqu'il s'efforce coûte que coûte de recentrer l'objet de son regard dans la seule perspective qui lui soit de quelque façon intelligible, ou sensée, c'est-à-dire la sienne, même si c'est par un refus obstiné (de céder à l'emprise de ce qui lui échappe).
Le caractère accidentel ou hasardeux de la chose n'est dû qu'au fait qu'il échappe en principe à votre (pre)science, votre contrôle, et donc à votre volonté : c'est donc une force au déroulement parfaitement réglé — qu'elle soit "aveugle" ou de quelque façon planifiée ne change rien en l'occurrence — qui vous plie à son caprice à votre corps défendant : ce que l'on peut parfaitement appeler "destin" dans le sens que j’ai dit, je crois.
Cela me rappelle une discussion que nous eûmes à propos du hasard, et dans le fond je ne changerais rien à ce que je vous écrivis alors : "jusqu'à plus ample informé, le hasard n'est que le résultat de l'impossibilité de rattacher un événement comme effet à une cause déterminante. À la survenue d'un tel événement on dit alors, façon de parler, qu'il est "dû" au hasard, mais ce n'est à mon avis que fallacieuse positivation d'un manque, d'une absence d'information."
Dans ce cas, vous en conviendrez, le clinamen ne peut être un "sans cause" en soi, seulement un "sans cause connue" par manque de faculté de résolution exhaustive du réel.
Mais je voudrais si vous permettez revenir à la question de la "signifiance" qu'il y aurait à se délivrer de tout destin, en prenant l'exact contre-pied de votre formule : Celui qui ne choisit pas est choisi, en faisant valoir que celui qui choisit de refuser d'être choisi atteint au plus haut degré de signifiance, précisément, dont il soit capable, puisqu'il s'efforce coûte que coûte de recentrer l'objet de son regard dans la seule perspective qui lui soit de quelque façon intelligible, ou sensée, c'est-à-dire la sienne, même si c'est par un refus obstiné (de céder à l'emprise de ce qui lui échappe).
| 24 mai 2017, 16:52 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
J'ajouterai ceci : la question de "l'adéquation au réel" se pose dans une optique camusienne, pour ainsi dire (celle d'Albert), parce qu'elle reprend l'attitude de Sisyphe face à un "destin" qui lui est totalement inintelligible, inexplicable, absurde, pour tout dire : or la seule façon cohérente, "signifiante" de contrer cet absurde est de lui être fidèle, de le reproduire par refus conscient et délibéré de ce qu’il est et de ce qu’il impose.
Autrement dit la seule lueur de sens qu’il puisse y avoir dans un monde insensé régi par une destin incompréhensible réside dans l’adéquation volontaire autant que révoltée à ce même non-sens.
« Vivre une expérience, un destin, c’est l’accepter pleinement. Or on ne vivra pas ce destin, le sachant absurde, si on ne fait pas tout pour maintenir devant soi cet absurde mis au jour par la conscience. (...) L'une des seules positions philosophiques cohérentes, c'est ainsi la révolte. Elle est un confrontement perpétuel de l'homme et de sa propre obscurité. »
Ce qui complique la donne initiale concernant le refus du destin et la signifiance, je vous l’accorde, car il faudrait dire maintenant : la seule façon de tirer quelque sens d’un destin inintelligible est de s’y conformer par radicale insoumission à ce qu’il est, car là, dans cette adéquation, réside notre seule ressource d'être dans le vrai.
Autrement dit la seule lueur de sens qu’il puisse y avoir dans un monde insensé régi par une destin incompréhensible réside dans l’adéquation volontaire autant que révoltée à ce même non-sens.
« Vivre une expérience, un destin, c’est l’accepter pleinement. Or on ne vivra pas ce destin, le sachant absurde, si on ne fait pas tout pour maintenir devant soi cet absurde mis au jour par la conscience. (...) L'une des seules positions philosophiques cohérentes, c'est ainsi la révolte. Elle est un confrontement perpétuel de l'homme et de sa propre obscurité. »
Ce qui complique la donne initiale concernant le refus du destin et la signifiance, je vous l’accorde, car il faudrait dire maintenant : la seule façon de tirer quelque sens d’un destin inintelligible est de s’y conformer par radicale insoumission à ce qu’il est, car là, dans cette adéquation, réside notre seule ressource d'être dans le vrai.
| 25 mai 2017, 19:41 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
| 26 mai 2017, 04:00 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
| 26 mai 2017, 04:08 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
| 26 mai 2017, 18:11 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
| 26 mai 2017, 18:15 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
(on remarquera au passage le jeu assez subtil de Thomas Hardy dans ces pages, où le mur du jardin figure l'hymen, dans une sorte de métaphore filée sous-jacente. La littérature existe pour ce genre de choses-là : nous éloigner, nous tenir à l'écart de la bête utilitaire, de l'idiotie mono-impulsée, du calcul inlassable où macèrent les envahissantes bassesses de la vie.)
| 27 mai 2017, 00:40 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
(un mot encore au passage : il n'est pas de littérature moins victorienne que la "littérature victorienne" -- toute la littérature de cette époque en Angleterre est dissidente -- les Soeurs Brontë, la grande George Eliot, Dickens ou Thomas Hardy tous les plus grands producteurs d'oeuvres littéraires "victoriennes" furent des dissidents de cette ère, de ce règne qui s'étendait sur la surface du globe : la littérature, au fond assez comme en Russie à la même époque et jusqu'au tournant du siècle, avant de reprendre à la mort de Lénine, était le lieu de la dissidence. Quand tout est perdu, ou, comme à présent en Europe quand tout n'est pas encore perdu, la littérature pure et belle est le lieu de ce combat, l'ultime et sublime combat politique réfractaire de ce qui, non content de refuser de mourir, prétend vouloir vivre encore et de nouveau).
| 27 mai 2017, 01:18 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
(La littérature mine la civilisation de l'intérieur mais d'une manière qui ne s'assimile en rien à de la trahison : elle mine le faux civilisationnel et politique, celui de la représentation de la civilisation par elle-même, en exaltant le réel et le possible. Comme ici dans cette petite nouvelle. En 1880, quand Hardy entreprend cette oeuvre étonnante (des dizaines de romans et nouvelles, des centaines de poèmes), les thalassocraties ibères et continentales, hollandaises, françaises ont toutes été réduites ou largement tenues en échec et les prétentions continentales de l'Empereur, et celles de l'Allemagne, toujours sans colonies dignes de ce nom, paraissent avoir été dérisoires à l'échelle du globe. L'Angleterre triomphe partout et sa thalassocratie règne enfin comme le siècle élisabéthain en avait rêvé. L'Angleterre en devient, au yeux du monde actif et désireux de se dépasser (comme l'Inde devait le montrer avec Gandhi), le tout de l'Occident. Etre occidental et civilisé, c'est prendre le thé à cinq heures, siroter un sherry en tirant sur des cigares , ou manier avec hardeur et élégance la batte de cricket tandis que les dames en dentelles s'exercent à des choses féminines. Que fait alors le romancier anglais ? Il verse sur cette admirable construction, unique dans l'histoire, car jamais empire n'avait été planétaire avant celui-là, de l'acide, du fiel et du miel, il mine et rogne l'édifice de l'intérieur, depuis son coeur, avec Thomas Hardy celui de l'Angleterre rurale, âme ancienne de la puissance civilisée et civilisatrice, et avec Dickens, celui de la machinerie urbaine, en exposant le sordide qui sert de loi fondamentale à ce monde de suie, de cambouis et de calcul pécuniaire. Ce paradoxe, celui d'une puissance qui tolère en son sein pareille dissidence active s'est retrouvé en Russie -- au fond, si l'on veut bien se pencher sur le phénomène Soljenitsine, qui fut un romancier, un créateur de monde projeté, imaginaire et politique, en portant sur son oeuvre le regard que je vous propose, on reconnaîtra dans l'Archipel du Goulag, un Bleak House ou un Little Dorit du Dickens russe.
La littérature d'empire en Occident est une belle indifférente à la gloire impériale -- le cas de Kipling est beaucoup plus ambigü qu'on ne croit généralement, Kim ou The Light that Failed ne sont déjà guère éloignés des premiers romans d'Aldous Huxley, celui du Meilleur des Mondes. Donc cette puissance paradoxale, l'Occident, rentrée presque tout entière dans la puissance anglaise victorienne dans cet âge-là, offre cette remarquable singularité de penser, dans les moments les plus stables de son histoire, contre elle-même, par le truchement d'esprits dissidents -- l'aimable Thomas Hardy, qui ne fut jamais un révolutionnaire, dut renoncer à écrire des romans après que son Jude The Obscure fut brûlé par un évêque de son cher Wessex, ce qui nous vaut les quelques neuf cents poèmes qu'il composa après cet incident, ayant résolu de recourir à ce mode d'expression artistique qui lui causerait moins de désagréments.
Hormis le Japon moderne, et la Chine brièvement, entre 1880 et 1949, je ne sais si une civilisation autre que celle-là, qui se paye avec confiance un luxe pareil, celui de s'auto-attaquer au faîte de sa gloire, existe ou a jamais existé. Rien que pour ce trait, invraisemblablement supérieur, je continuerai de voter pour que ce fascinant phénomène, l'Occident, ne disparaisse jamais, ne soit jamais enterré ou relativisé).
La littérature d'empire en Occident est une belle indifférente à la gloire impériale -- le cas de Kipling est beaucoup plus ambigü qu'on ne croit généralement, Kim ou The Light that Failed ne sont déjà guère éloignés des premiers romans d'Aldous Huxley, celui du Meilleur des Mondes. Donc cette puissance paradoxale, l'Occident, rentrée presque tout entière dans la puissance anglaise victorienne dans cet âge-là, offre cette remarquable singularité de penser, dans les moments les plus stables de son histoire, contre elle-même, par le truchement d'esprits dissidents -- l'aimable Thomas Hardy, qui ne fut jamais un révolutionnaire, dut renoncer à écrire des romans après que son Jude The Obscure fut brûlé par un évêque de son cher Wessex, ce qui nous vaut les quelques neuf cents poèmes qu'il composa après cet incident, ayant résolu de recourir à ce mode d'expression artistique qui lui causerait moins de désagréments.
Hormis le Japon moderne, et la Chine brièvement, entre 1880 et 1949, je ne sais si une civilisation autre que celle-là, qui se paye avec confiance un luxe pareil, celui de s'auto-attaquer au faîte de sa gloire, existe ou a jamais existé. Rien que pour ce trait, invraisemblablement supérieur, je continuerai de voter pour que ce fascinant phénomène, l'Occident, ne disparaisse jamais, ne soit jamais enterré ou relativisé).
|
Utilisateur anonyme
27 mai 2017, 18:38
Re : Thomas Hardy et le clinamen
|
Quand tout est perdu, ou, comme à présent en Europe quand tout n'est pas encore perdu, la littérature pure et belle est le lieu de ce combat, l'ultime et sublime combat politique réfractaire de ce qui, non content de refuser de mourir, prétend vouloir vivre encore et de nouveau
////
Méfiez-vous Francis. Car lorsqu'une quelconque nécessité, qu’elle soit historique, théologique, politique, économique ou littéraire, devient le critère ultime pour juger du réel, le réel n’est alors plus considéré comme tel que dans la mesure où il se plie à cette nécessité.
////
Méfiez-vous Francis. Car lorsqu'une quelconque nécessité, qu’elle soit historique, théologique, politique, économique ou littéraire, devient le critère ultime pour juger du réel, le réel n’est alors plus considéré comme tel que dans la mesure où il se plie à cette nécessité.
| 27 mai 2017, 22:23 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
| 30 mai 2017, 00:50 Re : Thomas Hardy et le clinamen |






Weymouth et Portland (Ile of Slingers), image tirée de l'excellent ouvrage The Heart of Wessex, mis en ligne ici :
[www.gutenberg.org]
| 31 mai 2017, 04:12 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
| 01 juin 2017, 04:48 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
| 01 juin 2017, 04:53 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
Traduisant cette nouvelle de T. Hardy, j'y retrouve un peu de l'atmosphère, du style même, de certaines histoires de Maupassant ; la nouvelle Deux amis, par exemple, qui fut publiée en France cinq années à peine avant celle-là, présente avec elle un air de famille. Je commence à penser, mais je peux me tromper, et peut-être est-ce la mention d'Albert Camus dans les prolégomènes supra qui m'y conduit, que l'irruption du destin chez les petites gens en littérature, autrement dit chez des personnes qui n'ont pas le moindre pouvoir sur leur vie, ensemença un certain existentialisme, toujours en littérature, française en particulier. Cette nouvelle de Hardy a du reste et à cet égard quelque chose de résolument continental, porteur d'un tragique anti-victorien au possible.
| 01 juin 2017, 22:24 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
| 02 juin 2017, 19:49 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
Il y en a eu assurément bien plus qu'une, Monsieur Marche, mais vous avez besoin d'être rassuré...
Merci donc pour cette belle traduction. Et j'invite tous les lecteurs qui sont, comme moi, des inconditionnels de Thomas Hardy à rejoindre la "Thomas Hardy Society" . Plus de détails via Google, où vous découvrirez que "...its aim is to promote the British novelist and poet’s works for both education and enjoyment. It is for scholars, students, readers, enthusiasts and anyone with an interest in Thomas Hardy". La cotisation est symbolique et les activités sont nombreuses, dont de belles sorties "à thème"... pour ceux qui n'habitent pas trop loin du "Wessex", naturellement !
Merci donc pour cette belle traduction. Et j'invite tous les lecteurs qui sont, comme moi, des inconditionnels de Thomas Hardy à rejoindre la "Thomas Hardy Society" . Plus de détails via Google, où vous découvrirez que "...its aim is to promote the British novelist and poet’s works for both education and enjoyment. It is for scholars, students, readers, enthusiasts and anyone with an interest in Thomas Hardy". La cotisation est symbolique et les activités sont nombreuses, dont de belles sorties "à thème"... pour ceux qui n'habitent pas trop loin du "Wessex", naturellement !
| 03 juin 2017, 01:04 Re : Thomas Hardy et le clinamen |
Je vous remercie du fond du coeur cher Monsieur.
J'apprends que par un hasard du calendrier , la Thomas Hardy Society celèbre aujourdhui 3 juin 2017 le 177e anniversaire de la naissance de l'écrivain, ce que j'ignorais, tant cette date anniversaire que l'événement. Ma traduction cette semaine de cette nouvelle tombait on ne peut mieux. Et après ça on dira que ce forum ne vit pas dans son époque!
Lien vers la page concernée de la THS : [www.hardysociety.org]
J'apprends que par un hasard du calendrier , la Thomas Hardy Society celèbre aujourdhui 3 juin 2017 le 177e anniversaire de la naissance de l'écrivain, ce que j'ignorais, tant cette date anniversaire que l'événement. Ma traduction cette semaine de cette nouvelle tombait on ne peut mieux. Et après ça on dira que ce forum ne vit pas dans son époque!
Lien vers la page concernée de la THS : [www.hardysociety.org]
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.